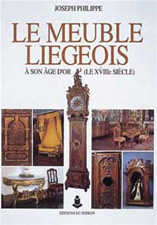Commode de
style Louis XV liégeois
Pourquoi parler de menuiserie d'art et non simplement du
meuble liégeois au XVIIIème siècle?
Rappelons que dans l'ancien Pays de Liège, les métiers étaient organisés
en corporations.
Les menuisiers et sculpteurs sur bois qui réalisaient, tant du mobilier
civil (armoires, commodes, tables, sièges, horloges...), que du mobilier
religieux (stalles, autels, chaires de vérité, confessionnaux, jubés,
buffets d'orgue...), mais aussi des boiseries décoratives du bâtiment
(lambris, cheminées, portes, escaliers...), appartenaient à la
corporation des charpentiers.
Il s'agit donc ici de traiter plus particulièrement des travaux réalisés
en bois massif, meubles ou boiseries décoratives.
Un autre aspect du meuble
liégeois, le mobilier de marqueterie quant à lui, relève plus
particulièrement du savoir-faire de l'ébéniste.
Cet exposé n'a pas l'ambition d'explorer toutes les facettes du mobilier
liégeois, d'autres en ont parlé (voir bibliographie). Nous laisserons le
soin aux historiens de l'art, antiquaires, ébénistes, menuisiers,
sculpteurs ou simples amateurs éclairés d'une analyse plus profonde et
précise sur l'un ou l'autre aspect de la remarquable originalité que
représente le meuble liégeois dans le contexte des arts décoratifs
européens du XVIIIème siècle.
retour
Les matériaux
Si le chêne est le bois le plus
utilisé pour le mobilier et les boiseries décoratives, le frêne, plus
flexible lui est préféré pour les sièges.
L'orme, le noyer, le merisier sont d'usage plus rare voire exceptionnel.
Le hêtre est employé pour les côtés de tiroir et les châssis de dos de
meuble. Les dos de meuble et fonds de tiroir sont fréquemment en bois
blanc, du moins pour les meubles les plus courants.
Les ferrures sont en laiton.
Les fiches, en deux parties, se composent d'une âme en fer gainée de
laiton dans lesquelles viennent s'enchâsser les vases en laiton massif.
Les entrées de serrures sont en tôle de laiton, parfois gravées et
repoussées; plus rare, elles sont coulées et ciselées.
On ouvre les tiroirs en les tirant par la clef; toutefois, les tiroirs
des commodes sont à poignées fixes ou à main pendante.
Les serrures sont en fer et placées sur le faux dormant quand le meuble
est à deux portes ; il est à trois ou quatre portes, elles sont fixées
sur les montants.
Les marbres sont utilisés uniquement pour les tablettes des consoles
d'applique et des tables à gibier ; le marbre le plus courant provient
des carrières de Saint-Remy à Rochefort; il présente une combinaison de
rouge, de blanc et de gris.
retour
La structure des meubles mosans
Les grands meubles liégeois
sont fabriqués en trois parties que l'on peut séparer lorsqu'il faut les
démonter : la base, le corps et le fronton ou la corniche. La base est
constituée du piétement, d'une moulure et d'un plancher. Elle se
présente sous trois aspects différents : elle repose parfois sur des
pieds tournés en forme de sphère aplatie, de toupie, de griffes de lion
serrant une boule ; elle a dans d'autres modèles la forme d'un socle
découpé ou non en patin ; elle peut aussi avoir des pieds cambrés en S
(reliés par des traverses chantournées) qui se terminent soit en sabot
de biche fendu (Régence), soit par une volute reposant sur un dé
octogonal (Louis XV et Transition), soit encore par des griffes de lion.
Ce troisième type de base se retrouve surtout sur les commodes, les
bureaux, les tables et les sièges. La façade du corps proprement dit est
constituée de portes et de tiroirs. Les angles verticaux des grands
meubles ont une forme bien particulière : ils sont en pans coupés plats
ou bombés, généralement avec ressauts ; ceux-ci sont simples, rentrants
ou sortants ; les mêmes ressauts existent quand les coins sont concaves,
en doucine ou à logette, c'est-à-dire avec deux arrondis, l'un concave
et l'autre convexe ; les angles des commodes et des bureaux sont le plus
souvent en quart-de-rond.
La corniche a une forme architecturale ; elle est plate, en accolade ou
cintrée ; la frise est réservée aux tiroirs ou, en leur absence, à des
motifs sculptés avec un encadrement mouluré.
retour
La
fabrication
Le bâti des meubles est
assemblé à tenon et mortaise ; les panneaux sont réunis aux montants et
aux traverses par des assemblages à rainures et languettes ; les portes
et les côtés des meubles sont assemblés à onglet.
Pour les tiroirs, les assemblages des côtés sont à queue d'aronde et à
queue d'aronde perdue ; ils s'ouvrent en glissant sur un coulisseau qui
s'emboîte dans une rainure pratiquée au centre de chaque côté.
retour
La
décoration
L’architecture des meubles
mosans est soulignée par une mouluration droite, horizontale et
verticale, et par des éléments courbes qui forment la traverse
supérieure des portes, la traverse inférieure chantournée de la base et
le cintre des corniches.
Les moulures sont composées de courbes concaves et convexes séparées par
un carré ; la corniche des grandes armoires Régence présente une
mouluration puissante à double ressaut.
Les sculptures sont toujours taillées en masse pleine sur une épaisseur
ne dépassant jamais 4 mm ; les motifs sculptés sont d'une grande finesse
et couvrent une grande partie de la façade, et même des côtés ; leur
abondance, leur texture serrée, leur faible relief et le fait qu'ils
sont ajourés font penser à un ouvrage de broderie ; le centre des
corniches, cintrées ou en arbalète, est souvent sculpté d'un médaillon,
d'un cartouche ou d'un mascaron, ou encore d'une coquille déchiquetée.
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, on a décoré des meubles " au
cordonnet ", c'est-à-dire de cordons faits d'une doucine avec des
volutes ; les cordons ceinturent les panneaux, les tiroirs, les portes,
les pilastres, les pans coupés ; ils s'étalent en compositions faites de
droites, de courbes et de contre-courbes en C et en S.
retour
Les styles
Si les divisions classiques,
liées au règne des rois de France ont été retenues, comme c’est le cas
habituellement, il faut souligner le fait que ces repères chronologiques
restent quelque peu arbitraires.
Si l'’influence des différentes
périodes esthétiques françaises est sensible dans ces créations,
l’originalité de ces meubles est telle que les dénominations de Louis XIV
liégeois, de Régence liégeois , de Louis XV et de Louis XVI liégeois
pourraient être écartées au profit d'un style Classique, d’une Rocaille
liégeoise, relativement insatisfaisante, voire d’un Rococo liégeois
(naissant, épanoui, assagi) et d’un néo-classique liégeois tout à fait
acceptable.
En dépit de ces questions de
terminologie, une analyse stylistique peut être menée. Quelques remarques
générales permettent de dégager une évolution :
l’évolution stylistique du
meuble liégeois du XVIIIème siècle est semblable à celle du meuble
français. Le bâti du meuble mosan gardera durant tout le siècle une
structure apparentée au style Louis XIV; seul le décor variera selon
l'époque considérée.
Le style Louis XIV liégeois
(1715-1730)
C'est en France l'époque du
style Régence, et à Liège l'époque du prince-évêque Georges Louis de
Berghes.
Les ornements sont symétriques et inscrits dans des encadrements
moulurés.
Le répertoire décoratif comprend les motifs suivants: coquilles,
feuilles d'acanthe, culots, palmettes, entrelacs, volutes et lambrequins
; les fonds sont quadrillés à fleurettes ou en écailles de poisson.
Le style Régence liégeois
(1730-1780)
Il comprend deux périodes
séparées par le Louis XV liégeois ; c'est le style le plus représentatif
du XVIIIème siècle mosan.
Durant la première période, la rocaille apparaît timidement,
rappelant la coquille et s'intégrant dans des compositions symétriques
qui utilisent des éléments de style Louis XIV et Louis XV; la structure
est de style Louis XIV.
Le style Louis XV liégeois
Apparu vers 1740, marque
le triomphe de la rocaille, nerveuse et déchiquetée ; les compositions,
asymétriques, se ressentent surtout du rococo allemand. Le style Louis
XV liégeois fut pratiquement inexistant ; il a duré pendant le règne du
prince-évêque Jean-Théodore de Bavière (1744-1765). On retrouve, dans
une composition asymétrique, les motifs suivants: la branche de roseau,
le rameau de feuillage avec ou sans fleurs, le motif " à la tour "
ou " à la ruine " en figuration perspective d'une muraille de moellons
avec arcade et branchage ; quant à la feuille d'acanthe, elle suit
toutes les contorsions de la rocaille.
Le style Régence liégeois
seconde période
Apparaît vers 1765 ;
cette période se caractérise par un apaisement des courbes des
contre-courbes et des rocailles, ainsi que par l'emploi de compositions
symétriques et asymétriques sur un même meuble.
Le style Louis XVI liégeois
Il se développe dès 1780
et se prolonge jusqu'en 1830 ; les ébénistes utilisent les motifs
du style Louis XVI français, tirés, comme on le sait, du répertoire
décoratif antique.
retour
Les
meubles
L’armoire,
appelée aussi " garde-robe " est haute et large ; elle est
destinée à la chambre, aux couloirs et aux vestibules pour y serrer les
vêtements et le linge de maison ; les vêtements sont pendus à des
crochets en bois fixés sur le fond du meuble ; la corniche est
généralement droite avec un ressaut au niveau du montant ; elle est
parfois cintrée en accolade avec un fronton sculpté en son centre.
Les armoires liégeoises sont à deux, trois ou quatre vantaux ; si elles
ont trois ou quatre vantaux, le corps central peut être en avancée ;
chaque porte comprend trois panneaux pour les premiers modèles Louis XIV
et deux pour les autres styles ; les tiroirs sont dans le bas du meuble,
derrière les portes ; ils ne sont donc pas visibles en façade ; les
pieds sont en forme de toupie ou à patins.
Il existe aussi une armoire bien particulière à la région de Liège ; il
s'agit de l' " armoire-penderie à régulateur ", qui, comme son nom
l'indique, consiste en un régulateur placé entre deux corps d'armoire de
la même hauteur que la gaine de l'horloge, mais un peu plus large ; le
fronton est surélevé en son milieu et contient le cadran ; il est
surmonté d'une corniche en plein cintre que jouxtent deux consoles
incurvées joignant les extrémités supérieures du meuble.
Le bas de buffet,
nommé également " bahut ", est une armoire à hauteur d'appui ; sa façade
est plate et rectangulaire et comporte deux, trois ou quatre portes à un
seul panneau et des tiroirs surmontant les portes ; quand le bahut a
trois ou quatre portes, la partie centrale est parfois en ressaut ; il
s'agit alors d'un bas de buffet privé de son corps supérieur. Les pieds
sont en boule ou à patins.
Le buffet
est un meuble à deux corps dont la partie supérieure, parfois pourvue de
tiroirs, est aveugle ou " en vitrine ". Le corps inférieur ressemble à
un bahut à deux ou trois portes, sommé d'un rang de tiroirs ; il repose
sur une plinthe découpée avec des patins ou sur des boules aplaties (six
lorsqu'il comporte une partie centrale en ressaut) ; le haut du buffet à
dessus fermé est toujours en retrait lorsque sa corniche est en accolade
; la partie centrale de certains buffets affecte la forme d'un
tabernacle. Si la corniche est droite, la façade du corps supérieur
n'est pas en retrait par rapport à celle du bas.
Le buffet-vitrine comprend un bas de buffet à deux ou trois vantaux,
toujours combiné avec des tiroirs, et un corps supérieur vitré formant
la vitrine proprement dite ; les angles sont également vitrés ; s'ils
forment une saillie très accusée par la combinaison de coins bombés
convexes et concaves, ils prennent le nom de " coins à logette " ; les
côtés du meuble peuvent aussi être vitrés.
Les vitrines de style Louis XIV ont généralement une corniche droite et
un corps supérieur de la même dimension que le corps inférieur, mais en
retrait ; les portes sont vitrées par des carreaux de petit format
séparés par des petits bois.
Pour les autres styles, la corniche est cintrée dans sa partie médiane
lorsque le corps est en tabernacle ; d'autres modèles ont une corniche
galbée en accolade avec deux plates-formes en plateau sur lesquelles on
avait l'habitude de déposer des porcelaines de Chine ou de Delft.
Le buffet-vitrine est un meuble destiné aux pièces d'apparat; il servait
au rangement et à l'exposition d'objets et de bibelots de grande valeur
ou de collection (faïences, porcelaines, argenterie, cristaux, etc.) ;
l'intérieur de la vitrine était peint en vert d'eau ou en bleu ciel
tirant sur le gris pour faire ressortir son précieux contenu.
La scribanne,
appelée aussi le " buffet-scriban ", apparaît à la fin du XVIIème siècle
pour servir de bureau, de secrétaire et de commode ; c'est un meuble à
deux corps ; le corps inférieur, ouvrant à portes ou à tiroirs, est
surmonté d'un serre-papiers fermé par un volet en pente qui peut se
rabattre à l'horizontale pour former table à écrire ; c'est un
secrétaire à dessus brisé ; le corps supérieur est généralement fermé
par deux vantaux qui, lorsqu'ils sont ouverts, laissent voir une
multitude de casiers, de tiroirs et de caves ; dans d'autres cas, il
peut être vitré ; il ressemble alors à une bibliothèque.
La commode
apparaît dans les intérieurs liégeois vers 1730.
Son bâti est rectangulaire et
sa façade généralement plate ; les côtés restent plans, même si la
façade est légèrement bombée ; elle possède d'ordinaire trois tiroirs,
parfois quatre ou cinq.
La façade peut être galbée en accolade, avec ou sans ressaut, ou en
arbalète ; s'il y a plusieurs ressauts, on l'appelle " en accordéon ";
l'ondulation de la surface ne se fait qu'en plan, donc jamais en
élévation et très rarement sur les côtés.
Généralement, la base est composée d'une traverse chantournée se
raccordant à des pieds de biche ou à des griffes de lion serrant une
sphère; la base peut également être formée d'une moulure droite
supportée par des boules aplaties ; on retiendra qu'entre 1740 et 1775
les courbes en C et en S et les fleurettes furent le motif de
prédilection des ébénistes mosans.
Le bureau
d'apparat ressemble très fort au bureau français de style Louis XIV à
huit pieds que l'on nomma " Mazarin" ; il est, bien entendu, en
marqueterie. Pour les bureaux en chêne, on trouve le bureau dit " de
notaire ", en dos d'âne avec un abattant en pente douce de chaque côté
d'une traverse centrale ; il repose sur quatre pieds hauts.
Le scriban
est un secrétaire à dessus brisé avec un abattant servant de table à
écrire ; c'est un meuble de prestige que l'on ne rencontre que dans les
riches demeures patriciennes.
La table
est une table-console à balustres droits ; elle est décorée sur la
ceinture triangulaire de quadrillés à fleurettes, d'enroulements de
courbes en C et en S avec une palmette centrale ; vers 1735, les pieds à
balustre font place à des pieds de biche terminés par un sabot.
Si la table est décorée sur ses quatre faces, elle prend le nom de
" table de milieu ".
La console d'applique est couverte d'une tablette de marbre ; son
tablier est assez important ; sa ceinture et ses deux pieds sont
fortement galbés et sculptés.
L’horloge de parquet
fut l'une des pièces les plus familières du mobilier liégeois ; la
plupart des horloges possèdent une caisse sculptée ; la gaine, ou
" corps ", est droite ou en forme de cercueil ; la porte de façade est
munie d'un oculus vitré qui permet de voir le mouvement du balancier ;
la base est plus large que le corps, elle est droite ou galbée en
s'élargissant vers le bas ; la tête, de forme rectangulaire, est
généralement plus large que le corps et sa porte vitrée laisse
apparaître un cadran en laiton et en étain avec des aiguilles en fer; ce
cadran, de forme carrée, est sommé d'un demi-cercle (cette forme est
dite " en chapelle " ; un disque bombé en étain, fixé sur la
partie supérieure du cadran, indique le nom de l'horloger, sa localité
et la date de fabrication du mouvement d'horlogerie ; la corniche de
nombreuses horloges est surmontée d'un caisson permettant d'y déposer un
vase ou une potiche de Delft ou de Chine.
Le siège
mélange très souvent des formes empruntées à des styles différents ; on
retiendra cependant une création typiquement régionale : le fauteuil à
haut dossier dit " de Herve ".
Le dossier, élevé, est plein et incliné ; il est assez étroit et fait
penser à la caquetoire de la Renaissance ; il se prolonge jusqu'à
l'assise du fauteuil. Le siège proprement dit est en bois et fortement
trapézoïdal. Les accotoirs sont de deux modèles : plats et s'évasant
vers l'extérieur, suivant ainsi la forme trapézoïdale du siège, ou
encore incurvés et se terminant par une volute. Les supports d'accotoirs
sont droits et situés dans le prolongement des pieds antérieurs ; la
ceinture peut être chantournée ou garnie de gouttes ou de cannelures ;
il n'y a jamais de traverse de ceinture à l'arrière ; les pieds sont
soit tournés en balustre, soit en gaine une entretoise en H ou en
trapèze relie les pieds assez près du sol lorsqu'il s'agit de pieds
tournés ; sa jonction avec les pieds se fait sur des dés de raccordement
cubiques ; la décoration se limite à la ceinture et au dossier, dont la
traverse supérieure est souvent chantournée ; seule l'assise est en
chêne, le reste est en frêne, ce bois convenant mieux pour les
assemblages. La région de Herve s'étendait de Visé jusqu'à la frontière
allemande.
retour
Composé d'extraits de : Dictionnaire du
meuble – Claude BOUZIN
Edition MASSIN - 2000
Bibliographie du meuble liégeois :
BERNARD Pierre -
Etude archéologique du meuble de menuiserie liégeois au XVIIIème siècle
Liège, Maison Curtius 2000
BOUZIN Claude
- Dictionnaire du meuble
Edition MASSIN - 2000
COLMAN Pierre et
Berthe - dans : Styles, meubles, décors, du Moyen Age à nos jours.
Publié sous la direction de Pierre VERLET
Edition LAROUSSE - 1972
DE BORCHGRAVE D'ALTENA
J. (Comte) -" Décors anciens
d'intérieurs mosans ", 4 t.
Liège, à partir de 1930
DEFOUR Frans
- SEPT SIECLE D’ART DU MEUBLE EN BELGIQUE
Du XIIIème au XXème siècle en Wallonie et en Flandre
Edition LANNOO-FONDS MERCATOR - 1977
DEFOUR Frans -
Belgische meubelkunst in Europa, vlaams en waals over de grenzen heen.
Drukkerij CREA 1993
FETTWEIS Henri
- Le musée d’Ansembourg à Liège
Feuillets archéologique de la société royale LE VIEUX LIEGE – 1960
MANNONI Edith -
Mobilier de Belgique et de la Flandre française.
Coll. : Le mobilier régional - Edition MASSIN 2001
MAUMENE Albert -
Maisons et meubles ardennais et wallons.
Coll. : Vie à la campagne, déc. 1930 - Edition Hachette
PHILIPPE J.
Le mobilier liégeois (moyen âge - XIXe siècle), Liège, 2e éd., 1968;
PHILIPPE J.
-
Meubles, styles et décors entre Meuse et Rhin, Liège, éd. Eugène Wahle,
1977.
PHILIPPE J.
- "Le meuble liégeois à son âge d'or le XVIIIe siècle"
éd. du Perron Liège - 1990
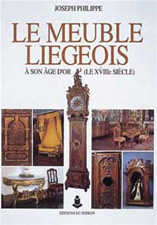
WOLVESPERGES Thibaut
- Le Meuble en Belgique – 1500-1800
Editions Racine – 2000 (texte français, néerlandais et anglais)
retour
Musées
Liste non exhaustive des musées belges
et étrangers ayant des meubles liégeois dans leurs collections.
Liège
Le musée d'Ansembourg,
Bruxelles
Musées Royaux d'Art et d'Histoire
Gand
Musée des Arts décoratifs
(Design Museum)
Modave
Château de Modave
Verviers
Musée d'archéologie et de folklore
Maastricht
Museum Spaans Gouvernement
Amsterdam
Rijksmuseum
Paris
Musée des Arts décoratifs
Aachen
Couven Museum
Berlin
Kunstgewerbemuseum
Kunstgewerbemuseum Köpenick
Dusseldorf
Kunstmuseum
Frankfurt
Museum für Kunsthandwerk
Hamburg
Museum für Kunst und Gewerbe
Köln
Kölnisches Stadtmuseum
Wetzlar
Palais Papius
Oslo
Museum of Applied art
retour
|